poèmes classiques
+6
davidof
sandrine jillou
Najat
Valerie-M-kaya
Rita-kazem
magda
10 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 poèmes classiques
poèmes classiques
Rappel du premier message :
poèmes classiques
Chant royal de la plus belle qui jamais fut au monde
Anges, Trônes et Dominations,
Principaultés, Archanges,
Chérubins,
Inclinez-vous aux basses régions
Avec Vertus, Potestés,
Seraphins,
Transvolitez des haults cieux cristalins
Pour decorer la
triumphante entrée
Et la très digne naissance adorée,
Le saint concept
par mysteres tres haults
De celle Vierge, ou toute grace abonde,
Decretee par dits imperiaulx
La plus belle qui jamais fut au
monde.
Faites sermons et predications,
Carmes devots, Cordeliers,
Augustins ;
Du saint concept portez relations,
Caldeyens, Hebrieux et
Latins ;
Roumains, chantez sur les monts palatins
Que Jouachim Saincte
Anne a rencontree,
Et que par eulx nous est administree
Ceste Vierge
sans amours conjugaulx
Que Dieu crea de plaisance feconde,
Sans poinct
sentir vices originaulx,
La plus belle qui jamais fut au monde.
Ses
honnestes belles receptions
D'ame et de corps aux beaux lieux
intestins
Ont transcendé toutes conceptions
Personnelles, par mysteres
divins.
Car pour nourrir Jhésus de ses doulx seins
Dieu l'a toujours sans
maculle monstree,
La déclarant par droit et loi oultree :
Toute belle
pour le tout beau des beaux,
Toute clère, necte, pudique et monde,
Toute
pure par dessus tous vesseaulx,
La plus belle qui jamais fut au
monde.
Muses, venez en jubilations
Et transmigrez vos ruisseaulx
cristalins,
Viens, Aurora, par lucidations,
En precursant les beaux jours
matutins ;
Viens, Orpheus, sonner harpe et clarins,
Viens, Amphion, de la
belle contree,
Viens, Musique, plaisamment acoustrée,
Viens, Royne
Hester, parée de joyaulx,
Venez, Judith, Rachel et Florimonde,
Accompagnez par honneurs spéciaulx
La plus belle qui jamais fut au
monde.
Tres doulx zephirs, par sibilations
Semez partout roses et
roumarins,
Nimphes, lessez vos inundations,
Lieux stigieulx et carybdes
marins ;
Sonnez des cors, violes, tabourins ;
Que ma maistresse, la Vierge
honnoree
Soit de chacun en tous lieux decoree
Viens, Apolo, jouer des
chalumeaux,
Sonne, Panna, si hault que tout redonde,
Collaudez tous en
termes generaulx
La plus belle qui jamais fut au monde.
Esprits
devotz, fidelles et loyaulx,
En paradis beaux manoirs et chasteaux,
Au
plaisir Dieu, la Vierge pour nous fonde
Ou la verrez en ses palais
royaulx,
La plus belle qui jamais fut au monde.
poèmes classiques
- Catherine d' AMBOISE
(?-1550)
Chant royal de la plus belle qui jamais fut au monde
Anges, Trônes et Dominations,
Principaultés, Archanges,
Chérubins,
Inclinez-vous aux basses régions
Avec Vertus, Potestés,
Seraphins,
Transvolitez des haults cieux cristalins
Pour decorer la
triumphante entrée
Et la très digne naissance adorée,
Le saint concept
par mysteres tres haults
De celle Vierge, ou toute grace abonde,
Decretee par dits imperiaulx
La plus belle qui jamais fut au
monde.
Faites sermons et predications,
Carmes devots, Cordeliers,
Augustins ;
Du saint concept portez relations,
Caldeyens, Hebrieux et
Latins ;
Roumains, chantez sur les monts palatins
Que Jouachim Saincte
Anne a rencontree,
Et que par eulx nous est administree
Ceste Vierge
sans amours conjugaulx
Que Dieu crea de plaisance feconde,
Sans poinct
sentir vices originaulx,
La plus belle qui jamais fut au monde.
Ses
honnestes belles receptions
D'ame et de corps aux beaux lieux
intestins
Ont transcendé toutes conceptions
Personnelles, par mysteres
divins.
Car pour nourrir Jhésus de ses doulx seins
Dieu l'a toujours sans
maculle monstree,
La déclarant par droit et loi oultree :
Toute belle
pour le tout beau des beaux,
Toute clère, necte, pudique et monde,
Toute
pure par dessus tous vesseaulx,
La plus belle qui jamais fut au
monde.
Muses, venez en jubilations
Et transmigrez vos ruisseaulx
cristalins,
Viens, Aurora, par lucidations,
En precursant les beaux jours
matutins ;
Viens, Orpheus, sonner harpe et clarins,
Viens, Amphion, de la
belle contree,
Viens, Musique, plaisamment acoustrée,
Viens, Royne
Hester, parée de joyaulx,
Venez, Judith, Rachel et Florimonde,
Accompagnez par honneurs spéciaulx
La plus belle qui jamais fut au
monde.
Tres doulx zephirs, par sibilations
Semez partout roses et
roumarins,
Nimphes, lessez vos inundations,
Lieux stigieulx et carybdes
marins ;
Sonnez des cors, violes, tabourins ;
Que ma maistresse, la Vierge
honnoree
Soit de chacun en tous lieux decoree
Viens, Apolo, jouer des
chalumeaux,
Sonne, Panna, si hault que tout redonde,
Collaudez tous en
termes generaulx
La plus belle qui jamais fut au monde.
Esprits
devotz, fidelles et loyaulx,
En paradis beaux manoirs et chasteaux,
Au
plaisir Dieu, la Vierge pour nous fonde
Ou la verrez en ses palais
royaulx,
La plus belle qui jamais fut au monde.

magda- Nombre de messages : 1253
Date d'inscription : 28/03/2010
 DANS VOS YEUX De Gaston Couté
DANS VOS YEUX De Gaston Couté
DANS VOS YEUX
De Gaston Couté (1880-1911)
Dans vos yeux
J'ai lu l'aveu de votre âme
En caractères de flamme
Et je m'en suis allé joyeux
Bornant alors mon espace
Au coin d'horizon qui passe
Dans vos yeux.
Dans vos yeux
J'ai vu s'amasser l'ivresse
Et d'une longue caresse
J'ai clos vos grands cils soyeux.
Mais cette ivresse fut brève
Et s'envola comme un rêve
De vos yeux.
Dans vos yeux
Profonds comme des abîmes
J'ai souvent cherché des rimes
Aux lacs bleus et spacieux
Et comme en leurs eaux sereines
J'ai souvent noyé mes peines
Dans vos yeux.
Dans vos yeux
J'ai vu rouler bien des larmes
Qui m'ont mis dans les alarmes
Et m'ont rendu malheureux.
J'ai vu la trace des songes
Et tous vos petits mensonges
Dans vos yeux.
Dans vos yeux
Je ne vois rien à cette heure
Hors que l'Amour est un leurre
Et qu'il n'est plus sous les cieux
D'amante qui soit fidèle
A sa promesse... éternelle
Dans vos yeux.
De Gaston Couté (1880-1911)
Dans vos yeux
J'ai lu l'aveu de votre âme
En caractères de flamme
Et je m'en suis allé joyeux
Bornant alors mon espace
Au coin d'horizon qui passe
Dans vos yeux.
Dans vos yeux
J'ai vu s'amasser l'ivresse
Et d'une longue caresse
J'ai clos vos grands cils soyeux.
Mais cette ivresse fut brève
Et s'envola comme un rêve
De vos yeux.
Dans vos yeux
Profonds comme des abîmes
J'ai souvent cherché des rimes
Aux lacs bleus et spacieux
Et comme en leurs eaux sereines
J'ai souvent noyé mes peines
Dans vos yeux.
Dans vos yeux
J'ai vu rouler bien des larmes
Qui m'ont mis dans les alarmes
Et m'ont rendu malheureux.
J'ai vu la trace des songes
Et tous vos petits mensonges
Dans vos yeux.
Dans vos yeux
Je ne vois rien à cette heure
Hors que l'Amour est un leurre
Et qu'il n'est plus sous les cieux
D'amante qui soit fidèle
A sa promesse... éternelle
Dans vos yeux.
sandrine jillou- Nombre de messages : 1700
Date d'inscription : 08/10/2008
 Le Corbeau: Edgar Allan Poe
Le Corbeau: Edgar Allan Poe
Le Corbeau
Edgar Allan Poe
Traduction de Charles Baudelaire
Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible
et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine
oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il
se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à
la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, – murmurai-je, – qui
frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela et rien de plus. »
Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre,
et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie.
Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de
mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore
perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment
Lénore, – et qu’ici on ne nommera jamais plus.
Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me
pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi
jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin pour apaiser le battement de mon
cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur attardé
sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; – c’est cela même, et
rien de plus. »
Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus
longtemps : « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité, j’implore votre
pardon ; mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper
si doucement, si faiblement vous êtes venu frapper à la porte de ma
chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors
j’ouvris la porte toute grande ; – les ténèbres, et rien de plus.
Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein
d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel
n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et
l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom
chuchoté : « Lénore ! » – C’était moi qui le chuchotais, et un écho à
son tour murmura ce mot : « Lénore ! » Purement cela, et rien de plus.
Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée,
j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement,
– dis-je, – sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre
; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur
se calmer un instant, et explorons ce mystère ; – c’est le vent, et
rien de plus. »
Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes,
entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la
moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ;
mais avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la
porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste
au-dessus de la porte de ma chambre ; – il se percha, s’installa, et
rien de plus.
Alors, cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la
sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire :
« Bien que ta tête, – lui dis-je, – soit sans huppe et sans cimier, tu
n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti
des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux
rivages de la nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la
parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût
pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut
donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa
chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la
porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que – Jamais plus !
Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra
que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son
âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, – jusqu’à
ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont
déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera
comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : «
Jamais plus ! »
Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos :
Sans doute, – dis-je, – ce qu’il prononce est tout son bagage de
savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur
impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses
chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De
profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : « Jamais
– jamais plus ! »
Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je
roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du
buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je
m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet
augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux,
sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire
entendre en croassant son – Jamais plus !
Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une
syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant
jusqu’au fond du cœur : je cherchai à deviner cela, et plus encore, ma
tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la
lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la
lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, – ah ! jamais plus !
Alors, il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir
invisible que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis
de ma chambre. « Infortuné ! – m’écriai-je, – ton Dieu t’a donné par
ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes
ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie
cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : «Jamais plus ! »
« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! mais
toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la
tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur
cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, –
dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un
baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : «
Jamais plus ! »
« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours
prophète ! par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux
nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis
lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment
Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges
nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon
! – hurlai-je en me redressant. – Rentre dans la tempête, retourne au
rivage de la nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire
comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude
inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de
mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit :
« Jamais plus ! »
Et le corbeau, immuable, est toujours installé sur le buste pâle de
Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont
toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la
lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et
mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le
plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus !
Edgar Allan Poe
Traduction de Charles Baudelaire
Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible
et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine
oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il
se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à
la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, – murmurai-je, – qui
frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela et rien de plus. »
Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre,
et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie.
Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de
mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore
perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment
Lénore, – et qu’ici on ne nommera jamais plus.
Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me
pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi
jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin pour apaiser le battement de mon
cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur attardé
sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; – c’est cela même, et
rien de plus. »
Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus
longtemps : « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité, j’implore votre
pardon ; mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper
si doucement, si faiblement vous êtes venu frapper à la porte de ma
chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors
j’ouvris la porte toute grande ; – les ténèbres, et rien de plus.
Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein
d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel
n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et
l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom
chuchoté : « Lénore ! » – C’était moi qui le chuchotais, et un écho à
son tour murmura ce mot : « Lénore ! » Purement cela, et rien de plus.
Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée,
j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement,
– dis-je, – sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre
; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur
se calmer un instant, et explorons ce mystère ; – c’est le vent, et
rien de plus. »
Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes,
entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la
moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ;
mais avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la
porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste
au-dessus de la porte de ma chambre ; – il se percha, s’installa, et
rien de plus.
Alors, cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la
sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire :
« Bien que ta tête, – lui dis-je, – soit sans huppe et sans cimier, tu
n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti
des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux
rivages de la nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la
parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût
pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut
donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa
chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la
porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que – Jamais plus !
Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra
que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son
âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, – jusqu’à
ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont
déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera
comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : «
Jamais plus ! »
Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos :
Sans doute, – dis-je, – ce qu’il prononce est tout son bagage de
savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur
impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses
chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De
profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : « Jamais
– jamais plus ! »
Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je
roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du
buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je
m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet
augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux,
sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire
entendre en croassant son – Jamais plus !
Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une
syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant
jusqu’au fond du cœur : je cherchai à deviner cela, et plus encore, ma
tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la
lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la
lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, – ah ! jamais plus !
Alors, il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir
invisible que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis
de ma chambre. « Infortuné ! – m’écriai-je, – ton Dieu t’a donné par
ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes
ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie
cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : «Jamais plus ! »
« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! mais
toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la
tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur
cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, –
dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un
baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : «
Jamais plus ! »
« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours
prophète ! par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux
nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis
lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment
Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges
nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon
! – hurlai-je en me redressant. – Rentre dans la tempête, retourne au
rivage de la nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire
comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude
inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de
mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit :
« Jamais plus ! »
Et le corbeau, immuable, est toujours installé sur le buste pâle de
Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont
toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la
lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et
mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le
plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus !

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700
loisirs : écrire, courir, vélo.
Date d'inscription : 08/10/2008
 LA MER De Charles Nérée Beauchemin
LA MER De Charles Nérée Beauchemin
LA MER
De Charles Nérée Beauchemin (1850-1931)
Loin des grands rochers noirs que baise la marée,
La mer calme, la mer au murmure endormeur,
Au large, tout là-bas, lente s'est retirée,
Et son sanglot d'amour dans l'air du soir se meurt.
La mer fauve, la mer vierge, la mer sauvage,
Au profond de son lit de nacre inviolé
Redescend, pour dormir, loin, bien loin du rivage,
Sous le seul regard pur du doux ciel étoilé.
La mer aime le ciel : c'est pour mieux lui redire,
À l'écart, en secret, son immense tourment,
Que la fauve amoureuse, au large se retire,
Dans son lit de corail, d'ambre et de diamant.
Et la brise n'apporte à la terre jalouse,
Qu'un souffle chuchoteur, vague, délicieux :
L'âme des océans frémit comme une épouse
Sous le chaste baiser des impassibles cieux.
De Charles Nérée Beauchemin (1850-1931)
Loin des grands rochers noirs que baise la marée,
La mer calme, la mer au murmure endormeur,
Au large, tout là-bas, lente s'est retirée,
Et son sanglot d'amour dans l'air du soir se meurt.
La mer fauve, la mer vierge, la mer sauvage,
Au profond de son lit de nacre inviolé
Redescend, pour dormir, loin, bien loin du rivage,
Sous le seul regard pur du doux ciel étoilé.
La mer aime le ciel : c'est pour mieux lui redire,
À l'écart, en secret, son immense tourment,
Que la fauve amoureuse, au large se retire,
Dans son lit de corail, d'ambre et de diamant.
Et la brise n'apporte à la terre jalouse,
Qu'un souffle chuchoteur, vague, délicieux :
L'âme des océans frémit comme une épouse
Sous le chaste baiser des impassibles cieux.

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700
loisirs : écrire, courir, vélo.
Date d'inscription : 08/10/2008
 HOTE MELANCOLIQUE: Flaminio De Birague
HOTE MELANCOLIQUE: Flaminio De Birague
HOTE MELANCOLIQUE
De Flaminio De Birague (1550- ?)
Hôte mélancolique
Des tombeaux et des croix,
J'errerai fantastique
Aux effroyables bois,
Compagnon des forêts
Et des démons secrets.
Les rochers solitaires,
Oreillers à mes sons,
Les Faunes et les Laires,
Rediront mes chansons,
Chansons tristes témoins
De mes funèbres soins.
Les Ombres éternelles
Des Mânes blêmissants
Sont beaucoup plus fidèles
A mes sens languissants
Que l'astre radieux
Qui redore les Cieux.
Hélas ce n'est moi-même
Qui forme ces accents !
Je suis là ombre blême,
Orphelin de mes sens,
Errant, idole affreuse,
Dans l'Orque ténébreux.
Vous donc Ombres sacrées
Des antres recélées,
Vous grottes emmurées,
De silence voilées,
Vous chenues forêts,
Assistez mes regrets.
Dans votre dure écorce,
Sous l'ombre de vos bras,
Gravez à toute force
Mon langoureux trépas,
Qui bornera mes voeux
Aux myrtes ombrageux...
De Flaminio De Birague (1550- ?)
Hôte mélancolique
Des tombeaux et des croix,
J'errerai fantastique
Aux effroyables bois,
Compagnon des forêts
Et des démons secrets.
Les rochers solitaires,
Oreillers à mes sons,
Les Faunes et les Laires,
Rediront mes chansons,
Chansons tristes témoins
De mes funèbres soins.
Les Ombres éternelles
Des Mânes blêmissants
Sont beaucoup plus fidèles
A mes sens languissants
Que l'astre radieux
Qui redore les Cieux.
Hélas ce n'est moi-même
Qui forme ces accents !
Je suis là ombre blême,
Orphelin de mes sens,
Errant, idole affreuse,
Dans l'Orque ténébreux.
Vous donc Ombres sacrées
Des antres recélées,
Vous grottes emmurées,
De silence voilées,
Vous chenues forêts,
Assistez mes regrets.
Dans votre dure écorce,
Sous l'ombre de vos bras,
Gravez à toute force
Mon langoureux trépas,
Qui bornera mes voeux
Aux myrtes ombrageux...

sandrine jillou- Nombre de messages : 1700
loisirs : écrire, courir, vélo.
Date d'inscription : 08/10/2008
 MIDI :Charles-Marie Leconte de Lisle
MIDI :Charles-Marie Leconte de Lisle

MIDI
De Charles-Marie Leconte de Lisle (1818-1894)
Midi, roi des étés, épandu sur la plaine,
Tombe en nappes d’argent des hauteurs du ciel bleu.
Tout se tait. L’air flamboie et brûle sans haleine ;
La terre est assoupie en sa robe de feu.
L’étendue est immense, et les champs n’ont point d’ombre,
Et la source est tarie où buvaient les troupeaux ;
La lointaine forêt, dont la lisière est sombre,
Dort là-bas, immobile, en un pesant repos.
Seuls, les grands blés mûris, tels qu’une mer dorée,
Se déroulent au loin, dédaigneux du sommeil ;
Pacifiques enfants de la terre sacrée,
Ils épuisent sans peur la coupe du soleil.
Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante,
Du sein des épis lourds qui murmurent entre eux,
Une ondulation majestueuse et lente
S’éveille, et va mourir à l’horizon poudreux.
Non loin, quelques bœufs blancs, couchés parmi les herbes,
Bavent avec lenteur sur leurs fanons épais,
Et suivent de leurs yeux languissants et superbes
Le songe intérieur qu’ils n’achèvent jamais.
Homme, si, le cœur plein de joie ou d’amertume,
Tu passais vers midi dans les champs radieux,
Fuis ! la nature est vide et le soleil consume :
Rien n’est vivant ici, rien n’est triste ou joyeux.
Mais si, désabusé des larmes et du rire,
Altéré de l’oubli de ce monde agité,
Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire,
Goûter une suprême et morne volupté,
Viens ! Le soleil te parle en paroles sublimes ;
Dans sa flamme implacable absorbe-toi sans fin ;
Et retourne à pas lents vers les cités infimes,
Le cœur trempé sept fois dans le néant divin.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 L'isolement D'Alphonse De Lamartine
L'isolement D'Alphonse De Lamartine

L'isolement
D'Alphonse De Lamartine (1790-1869)
Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne,
Au coucher du soleil, tristement je m'assieds ;
Je promène au hasard mes regards sur la plaine,
Dont le tableau changeant se déroule à mes pieds.
Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes ;
Il serpente, et s'enfonce en un lointain obscur ;
Là le lac immobile étend ses eaux dormantes
Où l'étoile du soir se lève dans l'azur.
Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres,
Le crépuscule encor jette un dernier rayon ;
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l'horizon.
Cependant, s'élançant de la flèche gothique,
Un son religieux se répand dans les airs :
Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts.
Mais à ces doux tableaux mon âme indifférente
N'éprouve devant eux ni charme ni transports ;
Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante
Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts.
De colline en colline en vain portant ma vue,
Du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant,
Je parcours tous les points de l'immense étendue,
Et je dis : " Nulle part le bonheur ne m'attend. "
Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ?
Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !
Que le tour du soleil ou commence ou s'achève,
D'un oeil indifférent je le suis dans son cours ;
En un ciel sombre ou pur qu'il se couche ou se lève,
Qu'importe le soleil ? je n'attends rien des jours.
Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,
Mes yeux verraient partout le vide et les déserts :
Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire;
Je ne demande rien à l'immense univers.
Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux,
Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre,
Ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux !
Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire ;
Là, je retrouverais et l'espoir et l'amour,
Et ce bien idéal que toute âme désire,
Et qui n'a pas de nom au terrestre séjour !
Que ne puîs-je, porté sur le char de l'Aurore,
Vague objet de mes voeux, m'élancer jusqu'à toi !
Sur la terre d'exil pourquoi resté-je encore ?
Il n'est rien de commun entre la terre et moi.
Quand là feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir s'élève et l'arrache aux vallons ;
Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie :
Emportez-moi comme elle, orageux aquilons !

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 PREMIER CHAGRIN De Charles Dovalle
PREMIER CHAGRIN De Charles Dovalle
PREMIER CHAGRIN
De Charles Dovalle (1807-1829)
Le bassin est uni : sur son onde limpide
Pas un souffle de vent ne soulève une ride ;
Au lever du soleil, chaque flot argenté
Court, par un autre flot sans cesse reflété ;
Il répète ses fleurs, comme un miroir fidèle ;
Mais la pointe des joncs sur la rive a tremblé...
Près du bord, qu'elle rase, a crié l'hirondelle...
Et l'azur du lac s'est troublé !
Au sein du bois humide, où chaque feuille est verte,
Où le gazon touffu boit la rosée en pleurs,
Où l'espoir des beaux jours rit dans toutes les fleurs,
Aux baisers du printemps, la rose s'est ouverte ;
Mais au fond du calice un insecte caché
Vit, déchirant la fleur de sa dent acérée...
Et la rose languit, pâle et décolorée
Sur son calice desséché !
De Charles Dovalle (1807-1829)
Le bassin est uni : sur son onde limpide
Pas un souffle de vent ne soulève une ride ;
Au lever du soleil, chaque flot argenté
Court, par un autre flot sans cesse reflété ;
Il répète ses fleurs, comme un miroir fidèle ;
Mais la pointe des joncs sur la rive a tremblé...
Près du bord, qu'elle rase, a crié l'hirondelle...
Et l'azur du lac s'est troublé !
Au sein du bois humide, où chaque feuille est verte,
Où le gazon touffu boit la rosée en pleurs,
Où l'espoir des beaux jours rit dans toutes les fleurs,
Aux baisers du printemps, la rose s'est ouverte ;
Mais au fond du calice un insecte caché
Vit, déchirant la fleur de sa dent acérée...
Et la rose languit, pâle et décolorée
Sur son calice desséché !

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Marceline Desbordes-Valmore:les séparés
Marceline Desbordes-Valmore:les séparés
Les Séparés
les séparés
De Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)
N'écris pas - Je suis triste, et je voudrais m'éteindre
Les beaux été sans toi, c'est la nuit sans flambeau
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre,
Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau
N'écris pas !
N'écris pas - N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes
Ne demande qu'à Dieu ... qu'à toi, si je t'aimais !
Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes,
C'est entendre le ciel sans y monter jamais
N'écris pas !
N'écris pas - Je te crains; j'ai peur de ma mémoire;
Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent
Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire
Une chère écriture est un portrait vivant
N'écris pas !
N'écris pas ces mots doux que je n'ose plus lire :
Il semble que ta voix les répand sur mon cœur;
Et que je les voix brûler à travers ton sourire;
Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur
N'écris pas !
les séparés
De Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)
N'écris pas - Je suis triste, et je voudrais m'éteindre
Les beaux été sans toi, c'est la nuit sans flambeau
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre,
Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau
N'écris pas !
N'écris pas - N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes
Ne demande qu'à Dieu ... qu'à toi, si je t'aimais !
Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes,
C'est entendre le ciel sans y monter jamais
N'écris pas !
N'écris pas - Je te crains; j'ai peur de ma mémoire;
Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent
Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire
Une chère écriture est un portrait vivant
N'écris pas !
N'écris pas ces mots doux que je n'ose plus lire :
Il semble que ta voix les répand sur mon cœur;
Et que je les voix brûler à travers ton sourire;
Il semble qu'un baiser les empreint sur mon coeur
N'écris pas !

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 CONTRALTO: De Théophile Gautier
CONTRALTO: De Théophile Gautier
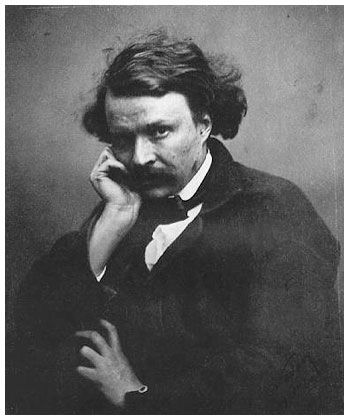
CONTRALTO
De Théophile Gautier (1811-1872)
On voit dans le Musée antique,
Sur un lit de marbre sculpté,
Une statue énigmatique
D'une inquiétante beauté.
Est-ce un jeune homme ? Est-ce une femme,
Une déesse, ou bien un dieu ?
L'amour, ayant peur d'être infâme,
Hésite et suspend son aveu.
Dans sa pose malicieuse,
Elle s'étend, le dos tourné
Devant la foule curieuse,
Sur son coussin capitonné.
Pour faire sa beauté maudite,
Chaque sexe apporta son don.
Tout homme dit : C'est Aphrodite !
Toute femme : C'est Cupidon !
Sexe douteux, grâce certaine,
On dirait ce corps indécis
Fondu, dans l'eau de la fontaine,
Sous les baisers de Salmacis.
Chimère ardente, effort suprême
De l'art et de la volupté,
Monstre charmant, comme je t'aime
Avec ta multiple beauté !
Bien qu'on défende ton approche,
Sous la draperie aux plis droits
Dont le bout à ton pied s'accroche,
Mes yeux ont plongé bien des fois.
Rêve de poète et d'artiste,
Tu m'as bien des nuits occupé,
Et mon caprice qui persiste
Ne convient pas qu'il s'est trompé.
Mais seulement il se transpose,
Et, passant de la forme au son,
Trouve dans sa métamorphose
La jeune fille et le garçon.
Que tu me plais, ô timbre étrange !
Son double, homme et femme à la fois,
Contralto, bizarre mélange,
Hermaphrodite de la voix !
C'est Roméo, c'est Juliette,
Chantant avec un seul gosier ;
Le pigeon rauque et la fauvette
Perchés sur le même rosier ;
C'est la châtelaine qui raille
Son beau page parlant d'amour ;
L'amant au pied de la muraille,
La dame au balcon de sa tour ;
Le papillon, blanche étincelle,
Qu'en ses détours et ses ébats
Poursuit un papillon fidèle,
L'un volant haut et l'autre bas ;
L'ange qui descend et qui monte
Sur l'escalier d'or voltigeant ;
La cloche mêlant dans sa fonte
La voix d'airain, la voix d'argent ;
La mélodie et l'harmonie,
Le chant et l'accompagnement ;
A la grâce la force unie,
La maîtresse embrassant l'amant !
Sur le pli de sa jupe assise,
Ce soir, ce sera Cendrillon
Causant prés du feu qu'elle attise
Avec son ami le grillon ;
Demain le valeureux Arsace
A son courroux donnant l'essor,
Ou Tancrède avec sa cuirasse,
Son épée et son casque d'or ;
Desdemona chantant le Saule,
Zerline bernant Mazetto,
Ou Malcolm le plaid sur l'épaule ;
C'est toi que j'aime, ô contralto !
Nature charmante et bizarre
Que Dieu d'un double attrait para,
Toi qui pourrais, comme Gulnare,
Etre le Kaled d'un Lara,
Et dont la voix, dans sa caresse,
Réveillant le cœur endormi,
Mêle aux soupirs de la maîtresse
L'accent plus mâle de l'ami !

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Nécropolis: De Théophile Dondey dit Philothée O'NEDDY
Nécropolis: De Théophile Dondey dit Philothée O'NEDDY
Nécropolis
De Théophile Dondey dit Philothée O'NEDDY (1811-1875)
I
Voici ce qu'un jeune squelette
Me dit les bras croisés, debout, dans son linceul,
Bien avant l'aube violette,
Dans le grand cimetière où je passais tout seul :
II
Fils de la solitude, écoute !
Si le Malheur, sbire cruel,
Sans cesse apparaît dans ta route
Pour t'offrir un lâche duel ;
Si la maladive pensée
Ne voit, dans l'avenir lancée,
Qu'un horizon tendu de noir :
Si, consumé d'un amour sombre,
Ton sang réclame en vain, dans l'ombre,
Le philtre endormeur de l'espoir ;
Si ton mal secret et farouche
De tes frères n'est pas compris ;
Si tu n'aperçois sur leur bouche
Que le sourire du mépris
Et si, pour assoupir ton âme,
Pour lui verser un doux dictame,
Le Destin, geôlier rigoureux,
Ne t'a pas, dans ton insomnie,
Jeté la lyre du génie,
Hochet des grands coeurs malheureux ;
Va, que la mort soit ton refuge !
À l'exemple du Rédempteur,
Ose à la fois être le juge,
La victime et l'exécuteur.
Qu'importe si des fanatiques
Interdisent les saints portiques
À ton cadavre abandonné ?
Qu'importe si, de mille outrages,
Par l'éloquence des faux sages,
Ton nom vulgaire est couronné ?
III
Sous la tombe muette oh ! Comme on dort tranquille !
Sans changer de posture, on peut, dans cet asile,
Des replis du linceul débarrassant sa main,
L'unir aux doigts poudreux du squelette voisin.
Il est doux de sentir des racines vivaces
Coudre à ses ossements leurs noeuds et leurs rosaces,
D'entendre les hurrahs du vent qui courbe et rompt
Les arbustes plantés au-dessus de son front.
C'est un ravissement quand la rosée amie,
Diamantant le sein de la côte endormie,
À travers le velours d'un gazon jeune et doux,
Bien humide et bien froide arrive jusqu'à vous.
Là, silence complet ; farniente sans borne.
Plus de rages d'amour ! le coeur stagnant et morne,
Ne se sent plus broyé sous la dent du remords.
- Certes, l'on est heureux dans les villas des morts !

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 COUCHANT D’HIVER:De Jules Laforgue
COUCHANT D’HIVER:De Jules Laforgue

COUCHANT D’HIVER
De Jules Laforgue (1860-1887)
Quel couchant douloureux nous avons eu ce soir!
Dans les arbres pleurait un vent de désespoir,
Abattant du bois mort dans les feuilles rouillées.
À travers le lacis des branches dépouillées
Dont l'eau-forte sabrait le ciel bleu-clair et froid,
Solitaire et navrant, descendait l'astre-roi.
Ô Soleil ! l'autre été, magnifique en ta gloire,
Tu sombrais, radieux comme un grand Saint-Ciboire,
Incendiant l'azur! À présent, nous voyons
Un disque safrané, malade, sans rayons,
Qui meurt à l'horizon balayé de cinabre,
Tout seul, dans un décor poitrinaire et macabre,
Colorant faiblement les nuages frileux
En blanc morne et livide, en verdâtre fielleux,
Vieil or, rose-fané, gris de plomb, lilas pâle.
Oh! c'est fini, fini! longuement le vent râle,
Tout est jaune et poussif; les jours sont révolus,
La Terre a fait son temps; ses reins n'en peuvent plus.
Et ses pauvres enfants, grêles, chauves et blêmes
D'avoir trop médité les éternels problèmes,
Grelottants et voûtés sous le poids des foulards
Au gaz jaune et mourant des brumeux boulevards,
D'un œil vide et muet contemplent leurs absinthes,
Riant amèrement, quand des femmes enceintes
Défilent, étalant leurs ventres et leurs seins,
Dans l'orgueil bestial des esclaves divins...
Ouragans inconnus des débâcles finales,
Accourrez! déchaînez vos trombes de rafales!
Prenez ce globe immonde et poussif! balayez
Sa lèpre de cités et ses fils ennuyés !
Et jetez ses débris sans nom au noir immense!
Et qu'on ne sache rien dans la grande innocence
Des soleils éternels, des étoiles d'amour,
De ce Cerveau pourri qui fut la Terre, un jour.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 La mort du Loup:D’Alfred de Vigny
La mort du Loup:D’Alfred de Vigny

La mort du Loup
D’Alfred de Vigny (1797-1863)
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l'horizon.
Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçus les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. -- Ni le bois, ni la plaine
Ne poussait un soupir dans les airs; Seulement
La girouette en deuil criait au firmament;
Car le vent élevé bien au dessus des terres,
N'effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d'en-bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s'étaient mis en quête
A regardé le sable en s'y couchant; Bientôt,
Lui que jamais ici on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçait la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient,
J'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse;
Mais les enfants du loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi,
Se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa louve reposait comme celle de marbre
Qu'adorait les romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s'assied, les deux jambes dressées,
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris,
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n'a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu, qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu'au dernier moment où le chien étranglé,
Mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang;
Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
Avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux, la belle et sombre veuve
Ne l'eut pas laissé seul subir la grande épreuve;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte des villes,
Que l'homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
Hélas! ai-je pensé, malgré ce grand nom d'Hommes,
Que j'ai honte de nous , débiles que nous sommes!
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C'est vous qui le savez sublimes animaux.
A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse,
Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse.
--Ah! je t'ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur.
Il disait: " Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté.
Gémir, pleurer prier est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler."

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 EPITAPHE:De Tristan Corbière
EPITAPHE:De Tristan Corbière

EPITAPHE
De Tristan Corbière (1845-1875)
Il se tua d'ardeur, ou mourut de paresse.
S'il vit, c'est par oubli; voici ce qu'il laisse:
- Son seul regret fut de n'être pas sa maîtresse. -
Il ne naquit par aucun bout,
Fut toujours poussé vent de bout,
Et ce fut un arlequin-ragoût,
Mélange adultère de tout.
Du je-ne-sais-quoi. - Mais ne sachant où;
De l'or, - mais avec pas le sou;
Des nerfs, - sans nerf. Vigueur sans force;
De l'élan, - avec une entorse;
De l'âme, - et pas de violon;
De l'amour, - mais pire étalon.
- Trop de noms pour avoir un nom. -
Coureur d'idéal, - sans idée;
Rime riche, - et jamais rimée;
Sans avoir été, - revenu;
Se retrouvant partout perdu.
Poète, en dépit de ses vers;
Artiste sans art, - à l'envers,
Philosophe, - à tort et à travers.
Un drôle sérieux, - pas drôle.
Acteur, il ne sut pas son rôle;
Peintre, il jouait de la musette;
Et musicien: de la palette.
Une tête! - mais pas de tête;
Trop fou pour savoir être bête;
Prenant un trait pour le mot très
- ses vers faux furent ses seuls vrais.
Oiseau rare - et de pacotille ;
Très mâle... et quelquefois très fille;
Capable de tout, - bon à rien ;
Gâchant bien le mal, mal le bien.
Prodigue comme était l'enfant
Du testament, - sans testament.
Brave et souvent, par peur du plat.
Coloriste enragé, - mais blême ;
Incompris... - surtout de lui-même ;
Il pleura, chanta juste faux;
- Et fut un défaut sans défauts.
Ne fut quelqu'un, ni quelque chose
Son naturel était la pose.
Pas poseur, - posant pour l'unique ;
Trop naïf, étant trop cynique ;
Ne croyant à rien, croyant tout.
- Son goût était dans le dégoût.
Trop cru, - parce qu'il fut trop cuit,
Ressemblant à rien moins qu'à lui,
Il s'amusa de son ennui,
Jusqu'à s'en réveiller la nuit.
Flâneur au large, - à la dérive,
Épave qui jamais n'arrive...
Trop soi pour se pouvoir souffrir,
L'esprit à sec et la tête ivre,
Fini, mais ne sachant finir,
Il mourut en s'attendant vivre
Et vécut, s'attendant mourir.
Ci-gît, - cœur, sans cœur, mal planté,
Trop réussi, - comme raté.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 PUISQUE J’AI MIS MA LEVRE…De Victor Hugo
PUISQUE J’AI MIS MA LEVRE…De Victor Hugo

PUISQUE J’AI MIS MA LEVRE…
De Victor Hugo (1802-1885)
Puisque j’ai mis ma lèvre à ta coupe encor pleine ;
Puisque j’ai dans tes mains posé mon front pâli ;
Puisque j’ai respiré parfois la douce haleine
De ton âme, parfum dans l’ombre enseveli ;
Puisqu’il me fut donné de t’entendre me dire
Les mots où se répand le cœur mystérieux ;
Puisque j’ai vu pleurer, puisque j’ai vu sourire
Ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux…
Je puis maintenant dire aux rapides années :
- passez ! passez toujours ! je n’ai plus à vieillir !
allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées ;
j’ai dans l’âme une fleur que nul ne peut cueillir !
votre aile en le heurtant ne fera rien répandre
du vase où je m’abreuve et que j’ai bien rempli.
Mon âme a plus de feu que vous n’avez de cendre !
Mon cœur a plus d’amour que vous n’avez d’oubli !

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Les Amis Inconnus:Jules Supervielle
Les Amis Inconnus:Jules Supervielle

Les Amis Inconnus
de Jules Supervielle (1884-1960) poète alliant la prose et la rime, le
bonheur et le malheur pour enfin s'acheminer vers le silence, le seul
"repos de l'âme".
Il vous naît un poisson qui se met à tourner
Tout de suite au plus noir d’une lampe profonde,
Il vous naît une étoile au-dessus de la tête,
Elle voudrait chanter mais ne peut faire mieux
Que ses sœurs de la nuit les étoiles muettes.
Il vous naît un oiseau dans la force de l’âge,
En plein vol, et cachant votre histoire en son cœur
Puisqu’il n’a que son cri d’oiseau pour la montrer.
Il vole sur les bois, se choisit une branche
Et s’y pose, on dirait qu’elle est comme les autres.
Il vous naît un ami, et voilà qu’il vous cherche
Il ne connaîtra pas votre nom ni vos yeux
Mais il faudra qu’il soit touché comme les autres
Et loge dans son cœur d’étranges battements
Qui lui viennent des jours qu’il n’auras pas vécus.
Pardon pour vous, pardon pour eux, pour le silence
Et les mots inconsidérés,
Pour les phrases venant de lèvres inconnues
Qui vous touchent de loin comme balles perdues,
Et pardon pour les fronts qui semblent oublieux.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 LA VOIE LACTÉE de Sully Prudhomme
LA VOIE LACTÉE de Sully Prudhomme

LA VOIE LACTÉE (Les Solitudes)
de Sully Prudhomme (1839-1907)
Aux étoiles j'ai dit un soir :
« Vous ne paraissez pas heureuses ;
Vos lueurs, dans l'infini noir,
Ont des tendresses douloureuses,
Et je crois voir au firmament
Un deuil blanc mené par des vierges
Qui portent d'innombrables cierges
Et se suivent languissamment.
Êtes-vous toujours en prière ?
Êtes-vous des astres blessés ?
Car ce sont des pleurs de lumière,
Non des rayons, que vous versez.
Vous les étoiles, les aïeules
Des créatures et des dieux,
Vous avez des pleurs dans les yeux... »
Elles m'ont dit : « Nous sommes seules,
Chacune de nous est très loin
Des soeurs dont tu la crois voisine ;
Sa clarté caressante et fine
Dans sa patrie est sans témoin ;
Et l'intime ardeur de ses flammes
Expire aux cieux indifférents. »
Je leur ai dit : « Je vous comprends !
Car vous ressemblez à nos âmes ;
Ainsi que vous chacune luit
Loin des soeurs qui semblent près d'elle,
Et la solitaire immortelle
Brûle en silence dans la nuit. »

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Madrigal triste:de Charles Baudelaire
Madrigal triste:de Charles Baudelaire

Madrigal triste
de Charles Baudelaire (1821-1867)
I
Que m'importe que tu sois sage ?
Sois belle ! et sois triste ! Les pleurs
Ajoutent un charme au visage,
Comme le fleuve au paysage ;
L'orage rajeunit les fleurs.
Je t'aime surtout quand la joie
S'enfuit de ton front terrassé ;
Quand ton coeur dans l'horreur se noie ;
Quand sur ton présent se déploie
Le nuage affreux du passé.
Je t'aime quand ton grand oeil verse
Une eau chaude comme le sang ;
Quand, malgré ma main qui te berce,
Ton angoisse, trop lourde, perce
Comme un râle d'agonisant.
J'aspire, volupté divine !
Hymne profond, délicieux !
Tous les sanglots de ta poitrine,
Et crois que ton coeur s'illumine
Des perles que versent tes yeux !
II
Je sais que ton coeur, qui regorge
De vieux amours déracinés,
Flamboie encor comme une forge,
Et que tu couves sous ta gorge
Un peu de l'orgueil des damnés ;
Mais tant, ma chère, que tes rêves
N'auront pas reflété l'Enfer,
Et qu'en un cauchemar sans trêves,
Songeant de poisons et de glaives,
Eprise de poudre et de fer,
N'ouvrant à chacun qu'avec crainte,
Déchiffrant le malheur partout,
Te convulsant quand l'heure tinte,
Tu n'auras pas senti l'étreinte
De l'irrésistible Dégoût,
Tu ne pourras, esclave reine
Qui ne m'aimes qu'avec effroi,
Dans l'horreur de la nuit malsaine,
Me dire, l'âme de cris pleine :
" Je suis ton égale, Ô mon Roi ! "

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Les Chants de Maldoror :de Lautréamont
Les Chants de Maldoror :de Lautréamont

Les Chants de Maldoror
de Lautréamont (1846-1870) (Extraits)
« Vieil océan, ta forme harmonieusement sphérique, qui
réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que
trop les petits yeux de l'homme, pareils à ceux du sanglier
pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la
perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est
cru beau dans tous les siècles. Moi, je suppose plutôt que
l'homme ne croit à sa beauté que par amour-propre; mais,
qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute; car,
pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de
mépris? Je te salue, vieil océan!
Vieil océan, tu es le symbole de l'identité: toujours
égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle,
et, si tes vagues sont quelque part en furie, plus loin, dans
quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet.
Tu n'es pas comme l'homme, qui s'arrête dans la rue, pour
voir deux boule-dogues s'empoigner au cou, mais, qui ne
s'arrête pas, quand un enterrement passe; qui est ce matin
accessible et ce soir de mauvaise humeur; qui rit aujourd'hui
et pleure demain. Je te salue, vieil océan! Vieil océan, il
n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein
de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la
baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux
avides des sciences naturelles les mille secrets de ton
intime organisation : tu es modeste. L'homme se vante sans
cesse, et pour des minuties. Je te salue, vieil océan!
Vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu
nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce
vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui
varient dans chacune d'elles, expliquent, d'une manière
satisfaisante, ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il
en est ainsi de l'homme, qui n'a pas les mêmes motifs
d'excuse. Un morceau de terre est-il occupé par trente
millions d'êtres humains, ceux-ci se croient obligés de ne
pas se mêler de l'existence de leurs voisins, fixés comme des
racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du
grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa
tanière, et en sort rarement pour visiter son semblable,
accroupi pareillement dans une autre tanière. La grande
famille universelle des humains est une utopie digne de la
logique la plus médiocre. En outre, du spectacle de tes
mamelles fécondes, se dégage la notion d'ingratitude; car, on
pense aussitôt à ces parents nombreux, assez ingrats envers
le Créateur, pour abandonner le fruit de leur misérable
union. Je te salue, vieil océan!
Vieil océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer
qu'à la mesure qu'on se fait de ce qu'il a fallu de puissance
active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas
t'embrasser d'un coup d'oeil. Pour te contempler, il faut que
la vue tourne son télescope, par un mouvement continu, vers
les quatre points de l'horizon, de même qu'un mathématicien,
afin de résoudre une équation algébrique, est obligé
d'examiner séparément les divers cas possibles, avant de
trancher la difficulté. L'homme mange des substances
nourrissantes, et fait d'autres efforts, dignes d'un meilleur
sort, pour paraître gras. Qu'elle se gonfle tant qu'elle
voudra, cette adorable grenouille. Sois tranquille, elle ne
t'égalera pas en grosseur; je le suppose, du moins. Je te
salue, vieil océan! Vieil océan, tes eaux sont amères. C'est
exactement le même goût que le fiel que distille la critique
sur les beaux-arts, sur les sciences, sur tout. Si quelqu'un
a du génie, on le fait passer pour un idiot; si quelque autre
est beau de corps, c'est un bossu affreux. Certes, il faut
que l'homme sente avec force son imperfection, dont les trois
quarts d'ailleurs ne sont dus qu'à lui-même, pour la
critiquer ainsi! Je te salue, vieil océan!
Vieil océan, les hommes, malgré l'excellence de leurs
méthodes, ne sont pas encore parvenus, aidés par les moyens
d'investigation de la science, à mesurer la profondeur
vertigineuse de tes abîmes; tu en as que les sondes les plus
longues, les plus pesantes, ont reconnu inaccessibles. Aux
poissons... ça leur est permis: pas aux hommes. Souvent, je
me suis demandé quelle chose était le plus facile à
reconnaître : la profondeur de l'océan ou la profondeur du
coeur humain ! Souvent, la main portée au front, debout sur
les vaisseaux, tandis que la lune se balançait entre les mâts
d'une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant
abstraction de tout ce qui n'était pas le but que je
poursuivais, m'efforçant de résoudre ce difficile problème!
Oui, quel est le plus profond, le plus impénétrable des deux
: l'océan ou le coeur humain? Si trente ans d'expérience de
la vie peuvent jusqu'à un certain point pencher la balance
vers l'une ou l'autre de ces solutions, il me sera permis de
dire que, malgré la profondeur de l'océan, il ne peut pas se
mettre en ligne, quant à la comparaison sur cette propriété,
avec la profondeur du coeur humain. J'ai été en relation avec
des hommes qui ont été vertueux. Ils mouraient à soixante
ans, et chacun ne manquait pas de s'écrier : « Ils ont fait
le bien sur cette terre, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la
charité : voilà tout, ce n'est pas malin, chacun peut en
faire autant. » Qui comprendra pourquoi deux amants qui
s'idolâtraient la veille, pour un mot mal interprété,
s'écartent, l'un vers l'orient, l'autre vers l'occident, avec
les aiguillons de la haine, de la vengeance, de l'amour et du
remords, et ne se revoient plus, chacun drapé dans sa fierté
solitaire. C'est un miracle qui se renouvelle chaque jour
et qui n'en est pas moins miraculeux. Qui comprendra pourquoi
l'on savoure non seulement les disgrâces générales de ses
semblables, mais encore les particulières de ses amis les
plus chers, tandis que l'on en est affligé en même temps? Un
exemple incontestable pour clore la série : l'homme dit
hypocritement oui et pense non. C'est pour cela que les
marcassins de l'humanité ont tant de confiance les uns dans
les autres et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie
beaucoup de progrès à faire. Je te salue, vieil océan!
Vieil océan, tu es si puissant, que les hommes l'ont
appris à leurs propres dépens. Ils ont beau employer toutes
les ressources de leur génie... incapables de te dominer. Ils
ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque
chose de plus fort qu'eux. Ce quelque chose a un nom. Ce nom
est : l'océan! La peur que tu leur inspires est telle,
qu'ils te respectent. Malgré cela, tu fais valser leurs plus
lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur
fais faire des sauts gymnastiques jusqu'au ciel, et des
plongeons admirables jusqu'au fond de tes domaines : un
saltimbanque en serait jaloux. Bienheureux sont-ils, quand
tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis
bouillonnants, pour aller voir, sans chemin de fer, dans tes
entrailles aquatiques, comment se portent les poissons, et
surtout comment ils se portent eux-mêmes. L'homme dit : « Je
suis plus intelligent que l'océan. » C'est possible; c'est
même assez vrai; mais l'océan lui est plus redoutable que
lui à l'océan : c'est ce qu'il n'est pas nécessaire de
prouver. Ce patriarche observateur, contemporain des
premières époques de notre globe suspendu, sourit de pitié,
quand il assiste aux combats navals des nations. Voilà une
centaine de léviathans qui sont sortis des mains de
l'humanité. Les ordres emphatiques des supérieurs, les cris
des blessés, les coups de canon, c'est du bruit fait exprès
pour anéantir quelques secondes. Il paraît que le drame est
fini, et que l'océan a tout mis dans son ventre. La gueule
est formidable. Elle doit être grande vers le bas, dans la
direction de l'inconnu! Pour couronner enfin la stupide
comédie, qui n'est pas même intéressante, on voit, au milieu
des airs, quelque cigogne, attardée par la fatigue, qui se
met à crier, sans arrêter l'envergure de son vol : « Tiens! ...
je la trouve mauvaise! Il y avait en bas des points
noirs; j'ai fermé les yeux : ils ont disparu. » Je te salue,
vieil océan!
Vieil océan, ô grand célibataire, quand tu parcours
la solitude solennelle de tes royaumes flegmatiques, tu
t'enorgueillis à juste titre de ta magnificence native, et
des éloges vrais que je m'empresse de te donner. Balancé
voluptueusement par les molles effluves de ta lenteur
majestueuse, qui est le plus grandiose parmi les attributs
dont le souverain pouvoir t'a gratifié, tu déroules, au
milieu d'un sombre mystère, sur toute ta surface sublime,
tes vagues incomparables, avec le sentiment calme de ta
puissance éternelle. Elles se suivent parallèlement,
séparées par de courts intervalles. A peine l'une diminue,
qu'une autre va à sa rencontre en grandissant, accompagnées
du bruit mélancolique de l'écume qui se fond, pour nous
avertir que tout est écume. (Ainsi, les êtres humains, ces
vagues vivantes, meurent l'un après l'autre, d'une manière
monotone; mais, sans laisser de bruit écumeux). L'oiseau de
passage se repose sur elles avec confiance, et se laisse
abandonner à leurs mouvements, pleins d'une grâce fière,
jusqu'à ce que les os de ses ailes aient recouvré leur
vigueur accoutumée pour continuer le pèlerinage aérien. Je
voudrais que la majesté humaine ne fût que l'incarnation du
reflet de la tienne. Je demande beaucoup, et ce souhait
sincère est glorieux pour toi. Ta grandeur morale, image de
l'infini, est immense comme la réflexion du philosophe,
comme l'amour de la femme, comme la beauté divine de
l'oiseau, comme les méditations du poète. Tu es plus beau
que la nuit. Réponds-moi, océan, veux-tu être mon frère?
Remue-toi avec impétuosité... plus... plus encore, si tu
veux que je te compare à la vengeance de Dieu; allonge tes
griffes livides, en te frayant un chemin sur ton propre
sein... c'est bien. Déroule tes vagues épouvantables, océan
hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe,
prosterné à tes genoux. La majesté de l'homme est empruntée;
il ne m'imposera point: toi, oui. Oh! quand tu t'avances, la
crête haute et terrible, entouré de tes replis tortueux
comme d'une cour, magnétiseur et farouche, roulant tes ondes
les unes sur les autres, avec la conscience de ce que tu es,
pendant que tu pousses, des profondeurs de ta poitrine,
comme accablé d'un remords intense que je ne puis pas
découvrir, ce sourd mugissement perpétuel que les hommes
redoutent tant, même quand ils te contemplent, en sûreté,
tremblants sur le rivage, alors, je vois qu'il ne
m'appartient pas, le droit insigne de me dire ton égal.
C'est pourquoi, en présence de ta supériorité, je te
donnerais tout mon amour (et nul ne sait la quantité d'amour
que contiennent mes aspirations vers le beau), si tu ne me
faisais douloureusement penser à mes semblables, qui forment
avec toi le plus ironique contraste, l'antithèse la plus
bouffonne que l'on ait jamais vue dans la création: je ne
puis pas t'aimer, je te déteste. Pourquoi reviens-je à toi,
pour la millième fois, vers tes bras amis, qui
s'entr'ouvrent, pour caresser mon front brûlant, qui voit
disparaître la fièvre à leur contact! Je ne connais pas ta
destinée cachée; tout ce qui te concerne m'intéresse.
Dis-moi donc si tu es la demeure du prince des ténèbres.
Dis-le moi... dis-le moi, océan (à moi seul, pour ne pas
attrister ceux qui n'ont encore connu que les illusions), et
si le souffle de Satan crée les tempêtes qui soulèvent tes
eaux salées jusqu'aux nuages. Il faut que tu me le dises,
parce que je me réjouirais de savoir l'enfer si près de
l'homme. Je veux que celle-ci soit la dernière strophe de
mon invocation. Par conséquent, une seule fois encore, je
veux te saluer et te faire mes adieux ! Vieil océan, aux
vagues de cristal... Mes yeux se mouillent de larmes
abondantes, et je n'ai pas la force de poursuivre; car, je
sens que le moment venu de revenir parmi les hommes, à
l'aspect brutal; mais... courage! Faisons un grand effort,
et accomplissons, avec le sentiment du devoir, notre
destinée sur cette terre. Je te salue, vieil océan! »

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Hymnes à la nuit de Novalis (extraits)
Hymnes à la nuit de Novalis (extraits)

Hymnes à la nuit de Novalis (extraits)
« Quel vivant, quel être sensible, n’aime avant tous les prodiges de
l’espace s’élargissant autour de lui, la joie universelle de la Lumière
- avec ses couleurs, ses rayons et ses vagues ; sa douce omniprésence
dans le jour qui éveille ? Âme la plus intime de la vie, elle est le
souffle du monde gigantesque des astres sans repos, et il nage en
dansant dans son flot bleu - elle est le souffle de la pierre
étincelante, éternellement immobile, de la plante songeuse, suçant la
sève et de l’animal sauvage, ardent, aux formes variées - mais, plus
que d’eux tous, de l’Étranger superbe au regard pénétrant, à la
démarche ailée et aux lèvres tendrement closes, riches de musique.
Comme une reine de la nature terrestre, elle appelle chaque force à
d’innombrables métamorphoses, noue et dénoue des alliances infinies,
enveloppe de sa céleste image chaque créature terrestre. - Sa présence
seule révèle la prodigieuse splendeur des royaumes de ce monde.
Vers le bas je me tourne, vers la sainte, l’ineffable, la mystérieuse
Nuit. Le monde est loin - sombré en un profond tombeau - déserte et
solitaire est sa place. Dans les fibres de mon cœur souffle une
profonde nostalgie. Je veux tomber en gouttes de rosée et me mêler à la
cendre. - Lointains du souvenir, souhaits de la jeunesse, rêves de
l’enfance, courtes joies et vains espoirs de toute une longue vie
viennent en vêtements gris, comme des brouillards du soir après le
coucher du soleil. La Lumière a planté ailleurs les pavillons de la
joie. Ne doit-elle jamais revenir vers ses enfants qui l’attendent avec
la foi de l’innocence ?
Que jaillit-il soudain de si prémonitoire sous mon cœur et qui absorbe
le souffle douceâtre de la nostalgie ? As-tu, toi aussi, un faible pour
nous, sombre Nuit ? Que portes-tu sous ton manteau qui, avec une
invisible force, me va à l’âme ? Un baume précieux goutte de ta main,
du bouquet de pavots. Tu soulèves dans les airs les ailes alourdies du
cœur. Obscurément, ineffablement nous nous sentons envahis par l’émoi -
je vois, dans un joyeux effroi, un visage grave, qui, doux et
recueilli, se penche vers moi, et sous des boucles infiniment emmêlées
montre la jeunesse chérie de la Mère. Que la Lumière maintenant me
semble pauvre et puérile - heureux et béni l’adieu du jour ! - Ainsi
c’est seulement parce que la Nuit détourne de toi les fidèles, que tu
as semé dans les vastitudes de l’espace les globes lumineux, pour
proclamer ta toute-puissance - ton retour - aux heures de ton
éloignement. Plus célestes que ces étoiles clignotantes, nous semblent
les yeux infinis que la Nuit a ouverts en nous. Ils voient plus loin
que les plus pâles d’entre ces innombrables armées stellaires - sans
avoir besoin de la Lumière ils sondent les profondeurs d’un cœur aimant
- ce qui remplit d’une indicible extase un espace plus haut encore.
Louange à la reine de l’univers, à la haute révélatrice de mondes
sacrés, à la protectrice du céleste amour - elle t’envoie vers moi -
tendre Bien-Aimée - aimable soleil de la Nuit, - maintenant je suis
éveillé - car je suis tien et mien - tu m’as révélé que la Nuit est la
vie - tu m’as fait homme - consume mon corps avec le feu de l’esprit,
afin que, devenu aérien, je me mêle à toi de plus intime façon et
qu’ainsi dure éternellement la Nuit Nuptiale. »

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Reflux de Pierre Reverdy.
Reflux de Pierre Reverdy.

Reflux de Pierre Reverdy.
Quand le sourire éclatant des façades déchire le décor fragile du
matin ; quand l'horizon est encore plein du sommeil qui s'attarde, les
rêves murmurant dans les ruisseaux des haies ; quand la nuit rassemble
ses haillons pendus aux basses branches, je sors, je me prépare, je
suis plus pâle et plus tremblant que cette page où aucun mot du sort
n'était encore inscrit. Toute la distance de vous à moi - de la vie qui
tressaille à la surface de la main au sourire mortel de l'amour sur sa
fin - chancelle, déchirée. La distance parcourue d'une seule traite
sans arrêt, dans les jours sans clarté et les nuits sans sommeil. Et,
ce soir, je voudrais, d'un effort surhumain, secouer toute cette
épaisseur de rouille - cette rouille affamée qui déforme mon coeur et
me ronge les mains. Pourquoi rester si longtemps enseveli sous les
décombres des jours et de la nuit, la poussière des ombres. Et pourquoi
tant d'amour et pourquoi tant de haine. Un sang léger bouillonne à
grandes vagues dans des vases de prix. Il court dans les fleuves du
corps, donnant à la santé toutes les illusions de la victoire. Mais le
voyageur exténué, ébloui, hypnotisé par les lueurs fascinantes des
phares, dort debout, il ne résiste plus aux passes magnétiques de la
mort. Ce soir je voudrais dépenser tout l'or de ma mémoire, déposer mes
bagages trop lourds. Il n'y a plus devant mes yeux que le ciel nu, les
murs de la prison qui enserrait ma tête, les pavés de la rue. Il faut
remonter du plus bas de la mine, de la terre épaissie par l'humus du
malheur, reprendre l'air dans les recoins les plus obscurs de la
poitrine, pousser vers les hauteurs - où la glace étincelle de tous les
feux croisés de l'incendie - où la neige ruisselle, le caractère dur,
dans les tempêtes sans tendresse de l'égoïsme et les dérisions
tranchantes de l'esprit.
La saveur du réel
Il marchait sur un pied sans savoir où il poserait l’autre. Au tournant
de la rue le vent balayait la poussière et sa bouche avide engouffrait
tout l’espace. Il se mit à courir espérant s’envoler d’un moment à
l’autre, mais au bord du ruisseau les pavés étaient humides et ses bras
battant l’air n’ont pu le retenir. Dans sa chute il comprit qu’il était
plus lourd que son rêve et il aima, depuis, le poids qui l’avait fait
tomber.
Pierre Reverdy.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 La Ballade de la geôle de Reading:par Oscar Wilde
La Ballade de la geôle de Reading:par Oscar Wilde

La Ballade de la geôle de Reading
par Oscar Wilde (1854-1900)
7 juillet 1896
1
Plus d’uniforme d’écarlate
Car rouges sont le sang, le vin,
Quand on le prit près de la morte,
Du sang et du vin sur les mains,
La pauvre morte qu’il aimait
Et dont il devint l’assassin.
Il marchait, habit gris râpé,
Parmi les Hommes en Procès,
Une casquette sur la tête.
Son pas semblait gai et léger,
Mais dans ses yeux ouverts au jour
Jamais ne vis tant de regret.
Tant de regret jamais ne vis
Dans les yeux d’un homme, levés
Vers la petite tente bleue
Qu’est le ciel pour les prisonniers,
Vers chaque nuage qui passe
Toutes voiles d’argent gonflées.
Parmi d’autres âmes en peine,
Dans l’autre cercle je marchais,
En me demandant si cet homme
Avait commis un grand forfait,
Quand une voix a dit tout bas :
« Ce gars-là va se balancer ».
Mon Dieu ! Les murs de la prison
Soudain se mirent à tourner ;
Le ciel au-dessus de ma tête
Brûla comme un casque d’acier.
Et bien qu’étant une âme en peine
Ma peine cessai d’éprouver.
Et je savais quelle hantise
Animait son pas et levait
Son regard vers le jour brutal
Tout habité par le regret :
Il avait tué son amour,
Aussi, pour cela, il mourrait.
***
Pourtant chacun tue ce qu’il aime,
Salut à tout bon entendeur.
Certains le tuent d’un oeil amer,
Certains avec un mot flatteur.
Le lâche se sert d’un baiser,
Et d’une épée l’homme d’honneur.
Certains le tuent quand ils sont jeunes,
Certains à l’âge de la mort,
L’un avec les mains du Désir,
Et l’autre avec les mains de l’Or.
Le plus humain prend un couteau :
Sitôt le froid gagne le corps.
Amour trop bref, amour trop long,
On achète, on vend son désir.
Certains le tuent avec des larmes
Et d’autres sans même un soupir.
Car si chacun tue ce qu’il aime,
Chacun n’a pas à en mourir.
***
A en mourir de mort honteuse
Par un sombre jour de disgrâce.
Chacun n’a pas la corde au cou
Ni de chiffon dessus la face.
Sous lui ses pieds ne tombent pas
Dans le grand vide de l’espace.
Il ne s’assied pas avec ceux
Qui restent pour le surveiller,
Au cas où il voudrait soustraire
A la prison son prisonnier,
Quand il laisse couler ses larmes
Ou quand il essaie de prier.
Il ne s’éveille pas pour voir
L’effroi dans le petit matin,
Un aumônier en robe blanche,
Un gendarme dur et chagrin,
Le gouverneur vêtu de noir,
Visage jaune du Destin.
Il ne se lève pas en hâte
Pour se vêtir en condamné,
Sous le rire gras du docteur
Qui note ses tics affolés,
Lui dont la montre fait le bruit
De coups de marteau assénés.
Et il ne ressent pas la soif
Qui vient lui sabler le gosier,
Quand le bourreau pousse la porte
Avec ses gants de jardinier,
Pour l’attacher de trois courroies
Qui tuent la soif de son gosier.
Point ne s’incline pour entendre
L’office funèbre qu’on lit,
Pas plus qu’il ne voit son cercueil
Quand son âme angoissée lui dit
Qu’il n’est pas mort, et qu’il pénètre
Au cœur de cet horrible abri.
Il ne regarde pas le ciel
Au-delà de ce toit de verre,
Et pour que meure son angoisse,
Lèvre d’argile sans prière,
Point ne sent sur sa joue qui tremble
De Caïphe un baiser de pierre.
2
Le soldat, habit gris râpé,
Fut six semaines à marcher,
Une casquette sur la tête.
Son pas semblait gai et léger,
Mais dans ses yeux ouverts au jour
Jamais ne vis tant de regret.
Tant de regret jamais ne vis
Dans les yeux d’un homme, levés
Vers la petite tente bleue
Qu’est le ciel pour les prisonniers,
Vers chaque nuage qui traîne
Sa toison blanche échevelée.
Sans mains tordues, comme ces hommes,
Ces pauvres hommes sans espoir,
Qui osent nourrir l’espérance
Dans le caveau du désespoir :
Il regardait vers le soleil
Et buvait l’air frais jusqu’au soir.
Sans mains tordues, sans une larme,
Sans un regard ni un soupir,
Il buvait l’air comme l’on boit,
Pour oublier, un élixir ;
La bouche pleine de soleil
Comme de vin ou de désir.
Et les âmes en peine et moi,
Dans l’autre cercle nous marchions.
Etions-nous maudits et coupables
D’un crime, d’un forfait ou non ?
Et nous regardions d’un oeil las
Le promis à la pendaison.
Etrange de l’apercevoir,
Passer d’un pas gai et léger.
Etrange ce regret surpris
Dans ses yeux vers le jour levés.
Etrange de penser enfin
Qu’il aurait sa dette à payer.
***
Le chêne et l’orme ont un feuillage
Qui pousse au temps des primevères ;
Lugubre est l’arbre du gibet,
Racine mordue des vipères.
Mais sec ou vert, l’homme y mourra
Avant les fruits que l’on espère.
Là-haut est le siège de grâce,
Où tous nos efforts veulent tendre.
Mais qui, à la corde de chanvre,
Du haut d’un échafaud veut pendre,
Ou par le col du meurtrier
Veut voir en dernier le ciel tendre ?
Danser au son des violons,
La Vie et l’Amour sont précieux.
Au son des luths, au son des flûtes,
Danser est rare et délicieux.
Mais pas de douceur quand on danse
En l’air, d’un pied souple et gracieux.
Nous l’observions, jour après jour,
Lourds de questions, l’œil indiscret,
En craignant que chacun de nous
Ne finisse sur le gibet,
Car qui sait vers quel rouge Enfer
L’âme aveugle peut s’égarer.
Bientôt le mort ne marcha plus
Parmi les Hommes en Procès,
Et je sus qu’il était debout
Dans le banc noir des accusés,
Et que, par bonheur ou malheur,
Jamais je ne le reverrais.
Tels des vaisseaux dans la tempête,
Nos deux chemins s’étaient croisés,
Sans même un signe et sans un mot,
Nous n’avions mot à déclarer ;
Nous n’étions pas dans la nuit sainte
Mais dans le jour déshonoré.
Entourés d’un mur de prison,
Nous n’étions que deux réprouvés,
Chassés tous deux du cœur du monde,
Et de Dieu même abandonnés :
Nous étions pris aux dents de fer
Du piège tendu au péché.
3
Dans la cour les pavés sont durs,
Le mur suintant est élevé.
C’était ici qu’il prenait l’air
Sous le ciel de plomb, escorté
(Car on craignait que l’homme meure),
Par deux gardiens à ses côtés.
Ou il s’asseyait avec ceux
Qui jour et nuit le surveillaient,
Au cas où il voudrait soustraire
A l’échafaud son condamné,
Quand il se levait pour pleurer,
Quand il se baissait pour prier.
Le gouverneur se montrait ferme
Sur le règlement, la pratique.
Le docteur expliquait la mort
Comme un simple fait scientifique.
L’aumônier laissait chaque jour
Un opuscule en viatique.
Deux fois par jour un pot de bière
Et une pipe qu’il fumait,
Et dans son âme résolue
La peur ne pouvait se cacher.
Souvent il se disait heureux
Que le jour du bourreau soit près.
Pourquoi cette parole étrange
Qu’aucun gardien ne demandait ?
Car celui qui a pour destin
D’être gardien, de surveiller,
Doit avoir pour visage un masque
Et garder les lèvres scellées.
Sinon il pourrait s’émouvoir,
Essayer de réconforter.
Que ferait la Pitié Humaine
Dans le Trou clos des Meurtriers ?
Quel mot de grâce en un tel lieu
Dire à son frère pour l’aider ?
Nous nous traînions dans notre cercle
Comme des Fous à la Parade !
Peu importait, car nous étions
Du Diable la triste Brigade :
Tête rasée et pieds de plomb,
Quelle joyeuse mascarade !
Rompre la corde goudronnée
En étoupe, les doigts en sang.
Récurer portes et planchers,
Puis frotter les barreaux brillants,
Sur deux rangs savonner le sol,
Et cogner nos seaux bruyamment.
Coudre des sacs, casser des pierres,
Et, dans la poussière, forer.
Hurler un cantique en heurtant
Nos quarts, et au moulin suer.
Au fond de nos cœurs, immobile,
Une terreur veillait cachée.
Comme une mer alourdie d’algues
Les jours se traînaient lentement.
On oublia le lot amer
De la dupe et du chenapan.
Mais un soir, rentrant de corvée
On passa près d’un trou béant.
La gueule jaune de la tombe
Une proie vivante attendait,
Et la boue réclamait du sang
Au cercle d’asphalte assoiffé.
Nous sûmes qu’avant l’aube claire
Un homme se balancerait.
La Mort, la Peur et le Destin,
Nous laissèrent l’âme occupée.
Le bourreau et son petit sac
Traversèrent l’obscurité :
Chacun trembla en se glissant
Dans sa tombe numérotée.
***
Ce soir-là, des formes de peur
Remplirent les couloirs déserts ;
Des pas glissèrent en silence
Dans toute la cité de fer ;
Près des barreaux, nuit sans étoiles,
Des visages blêmes guettèrent.
Il reposait comme on repose
Et rêve, en un plaisant jardin.
Les gardiens l’observaient dormir
Et se demandaient incertains :
Comment peut-on rester si calme
Quand le bourreau vient au matin ?
Point de sommeil quand vont pleurer
Ceux-là qui n’ont jamais pleuré :
Car nous - escrocs, dupes, fripons -
Toute la nuit avons veillé.
Nos esprits et nos mains de peine
Vivaient la peur du condamné.
***
Eprouver le remords d’un autre !
Comment supporter cette horreur ?
Percés de l’épée du Péché
Jusqu’à sa garde de malheur.
Le sang que nous n’avions versé
Coulait dans le plomb de nos pleurs.
Et les gardiens chaussés de feutre
Venaient aux portes verrouillées
Pour observer, l’œil plein d’effroi,
Des hommes gris agenouillés,
Etonnés de voir en prière
Ceux qui n’avaient jamais prié.
Nuit de prières à genoux,
Comme les veilleurs fous d’un mort !
Les plumets troublés de minuit
Plumets de voiture des morts.
L’éponge trempée de vinaigre
Avait l’âcreté du remords.
Chant du coq gris, puis du coq rouge,
Mais le jour ne s’est pas levé.
Les formes tordues de la peur
Rampaient où nous étions couchés.
Les esprits malins de la nuit
Par devant nous semblaient jouer.
Ils passaient et repassaient vite,
Tels des voyageurs dans la brume,
En délicats tours et détours
D’un rigodon devant la lune.
Au rendez-vous vinrent les spectres,
Grâce formelle, inopportune.
On les vit s’enfuir grimaçants,
Ombres frêles, main dans la main ;
Ici et là, troupe fantôme
Qui menait le bal du Malin.
Arabesques, damnés grotesques,
Le vent sur le sable au matin !
Pirouettes de marionnettes,
Danse des pieds, danse des corps,
Et leurs flûtes soufflaient la peur.
Un chant si long, un chant si fort,
Pour une affreuse mascarade,
Un chant à réveiller le mort.
Ho ! Criaient-ils. Le monde est vaste !
Boiteux sont les pieds entravés !
Jeter les dés une ou deux fois
Est un jeu des plus distingués.
Dans la triste Maison de Honte,
Perd qui joue avec le Péché.
***
Ces bouffons étaient bien réels
Qui folâtraient avec gaîté.
Pour ceux qui étaient dans les fers,
Dont les vies souffraient enchaînées,
Plaies du Christ ! Ils étaient vivants
Et terribles à regarder.
Ici, là, ils valsaient, tournaient ;
Ceux-là, en couple, minaudant ;
Dans l’escalier, une cocotte
A pas menus, allait devant ;
Ricanement, oeillade en coin,
Dans nos prières nous aidant.
***
Le vent du matin a gémi
Mais la nuit poursuivit sa veille,
Car sur son métier géant, l’ombre
Tissait sa trame de merveille.
Et en priant, nous prenions peur
De la justice du Soleil.
Le vent du chagrin vint rôder
Aux murs de la prison des pleurs,
Et une roue d’acier grava
Chaque minute en notre cœur.
Vent du chagrin ! Qu’avions-nous fait
Pour mériter tel commandeur ?
Puis je vis l’ombre des barreaux
Comme un treillis de plomb fondu,
Devant mon lit fait de trois planches,
Trembler sur le mur blanc et nu.
Et, sur le monde, la terrible
Aurore de Dieu répandue.
***
A six heures, grand nettoyage,
A sept heures, tout se calmait.
Mais l’envol d’une aile puissante
Dans la prison sembla vibrer.
Souffle glacé, le Dieu de Mort,
Venait d’y entrer pour tuer.
Il n’avait pas l’éclat du pourpre,
Ne montait pas de blanc coursier.
Rien qu’une corde et une trappe
Que la potence réclamait ;
Le Héraut du lacet de honte
Accomplissait l’acte secret.
***
Comme des hommes qui tâtonnent
Dans l’ordure d’un marais noir,
Nous n’osions dire une prière
Ni montrer notre désespoir.
Une chose était morte en nous
Et cette chose était l’Espoir.
La sinistre Justice humaine
Suit droit sa route rigoureuse.
Fauche le fort, fauche le faible,
D’une démarche malheureuse.
D’un talon de fer tue le fort,
La parricide monstrueuse !
***
Et nous attendions les huit heures,
La langue de soif épaissie ;
Les huit coups sont ceux du Destin
Par lequel un homme est maudit.
Le Destin prend un nœud coulant
Pour le meilleur et le bandit.
Car nous n’avions rien d’autre à faire
Qu’attendre que l’heure ait sonné.
Comme des rochers solitaires
Nous restions sans bouger, muets,
Mais chaque cœur battait très fort
Comme un tambour de forcené !
***
Puis l’horloge de la prison
A fait vibrer l’air brusquement,
Et la geôle émit une plainte
Dans son désespoir impuissant,
Cri de lépreux dans son repaire
Au fond de marais effrayants.
Comme on voit des choses horribles
Dans le cristal d’un rêve enfui,
Nous vîmes la corde de chanvre
Fixée à la poutre noircie,
Et le bourreau qui étranglait
Une prière dans un cri.
Cette douleur qui l’étreignit,
Jusqu’à pousser ce cri hanté,
Regrets violents, sueur de sang,
Nul mieux que moi ne les connaît :
Qui a vécu plus d’une vie,
Plus d’une mort doit éprouver.
4
Pas d’office dans la chapelle
Le jour où un homme est pendu.
L’aumônier a le cœur trop faible
Ou le visage trop tendu,
Ou ce qui s’écrit dans ses yeux
Par aucun ne doit être lu.
On nous boucle jusqu’à midi,
Puis on sonne la cloche vive.
Des gardiens la clef sonore ouvre
Les cellules trop attentives.
Pour prendre l’escalier de fer
De son Enfer chacun s’esquive.
Dans l’air pur de Dieu nous sortons,
Mais pas comme à l’accoutumée,
Car un visage est blanc de peur,
Gris l’autre visage levé,
Mais dans des yeux ouverts au jour
Jamais ne vis tant de regret.
Tant de regret jamais ne vis
Dans les yeux des hommes, levés
Vers la petite tente bleue
Qu’est le ciel pour les prisonniers,
Vers chaque nuage qui passe
Dans une heureuse liberté.
Parmi nous, il y avait ceux
Qui avançaient tête baissée.
Ils savaient qu’une vraie justice
Aurait dû les exécuter.
Il n’avait tué qu’un vivant.
Eux, c’est le mort qu’ils avaient tué.
Car celui qui pèche deux fois
Livre une âme morte aux tourments,
L’extrait de son linceul taché,
Fait à nouveau couler son sang,
Fait couler d’énormes caillots,
Et la fait saigner vainement !
***
Singes, clowns, habits monstrueux
Marqués de flèches étoilées,
Nous tournions, sans fin, en silence,
Glissant dans le cercle asphalté,
Nous tournions, sans fin, en silence,
Sans qu’un seul mot soit prononcé.
Nous tournions, sans fin, en silence,
Et soufflait le terrible vent,
Dans l’esprit vide de chaque homme,
De ses souvenirs effrayants.
Car si l’Horreur rampait derrière,
La Terreur paradait devant.
***
Surveillant leur troupeau de brutes,
Tous les gardiens se rengorgeaient,
Avec leur tenue du dimanche,
L’uniforme qui reluisait ;
Mais la chaux vive de leur bottes
Nous disait ce qu’ils avaient fait.
Il n’y avait que sable et boue
Où s’était ouverte la tombe.
Le long des murs de la prison
On ne voyait aucune tombe.
Un petit tas de chaux ardente
Servait de linceul à cette ombre.
Ce misérable a un linceul
Que peu pourraient revendiquer :
Au fond d’une cour de prison,
Et pour sa honte dénudée,
C’est là qu’il gît, les fers aux pieds,
D’un drap de flamme enveloppé.
Très lentement, la chaux ardente
Ronge chair et os tour à tour ;
Pendant la nuit, les os cassants,
La chair tendre pendant le jour ;
Ronge chair et os lentement,
Mais ronge les cœurs pour toujours.
***
Pendant trois ans, on ne pourra
Ici, ni planter ni semer.
Pendant trois ans, l’endroit maudit
Sera stérile et désolé,
Et, sans reproche, il fixera
Le ciel d’un regard étonné.
Un cœur d’assassin souillerait,
Croient-ils, le grain semé ici.
Faux ! La tendre terre de Dieu
Est plus tendre qu’on ne le dit.
La rose rouge y est plus rouge,
Et la rose blanche y fleurit.
Pour sa bouche une rose rouge
Et une blanche pour son cœur.
Qui peut savoir comment le Christ
Nous dit son chemin de Sauveur ?
Le bâton sec du pèlerin
Devant le pape ouvre ses fleurs.
***
Les roses blanches de lait ou rouges,
Ici, jamais ne fleuriront.
Car on ne veut nous accorder
Que cailloux, silex et tessons.
Ils savent que les fleurs apaisent
Le désespoir de la prison.
Et des roses rouges ou blanches,
Jamais pétales ne tomberont
Sur ce sable et sur cette boue,
Près de l’affreux mur de prison,
Pour dire à ceux qui tournent là :
Christ est mort pour votre pardon.
***
Aussi, bien que le mur affreux
L’entoure de tous les côtés,
Bien qu’un esprit ne puisse errer
La nuit avec les fers aux pieds,
Bien qu’il ne puisse que pleurer
Qui repose en terre damnée,
Il est en paix - ce misérable -
Ou la paix sera vite en lui :
Plus rien ne peut le rendre fou,
Pas de Terreur en plein midi,
Car il n’est ni Soleil ni Lune
Dans la Terre obscure où il gît.
***
Ils l’ont pendu comme une bête :
Le glas n’a même pas sonné,
Un requiem qui eût offert
La paix à son âme angoissée.
Puis ils l’ont emporté très vite
Et dans un trou ils l’ont caché.
Ils lui ont ôté ses habits,
Aux mouches l’ont abandonné :
Ils ont raillé son regard fixe
Et sa gorge rouge et enflée,
Puis ont jeté avec un rire
Leur linceul sur leur condamné.
Et l’aumônier n’a pas prié
Sur sa tombe déshonorée,
Ne l’a pas marquée de la Croix
Qu’aux pécheurs le Christ a donnée ;
Pourtant cet homme était de ceux
Que Jésus descendit sauver.
Mais tout est bien ; il a franchi
La borne à la Vie assignée :
Les larmes d’autrui empliront
L’urne brisée de la Pitié ;
Des réprouvés le pleureront ;
Toujours pleurent les réprouvés.
5
Je ne sais si la Loi a tort
Ou si la Loi est équitable ;
En prison on sait seulement
Que le mur est infranchissable ;
Que chaque jour est une année
Dont les jours sont interminables.
Mais je sais que la Loi conçue
Par l’homme pour l’homme, depuis
Qu’un homme osa tuer son frère
Et que ce triste monde vit,
Jette le grain, garde l’ivraie
Dans le fond de son van maudit.
Je sais aussi - il serait sage
Que chacun en soit informé -
Que les prisons bâties par l’homme
Sont de briques d’iniquité,
De barreaux pour cacher au Christ
L’homme par l’homme mutilé.
Des barreaux la lune est confuse
Et le bon soleil aveuglé ;
Ils ont bien raison de cacher
Leur Enfer, car ce qu’on y fait
Le fils de Dieu, le fils de l’homme
Ne doivent pas le contempler !
***
Les viles actions, comme l’herbe
Empoisonnée s’y épanouissent ;
Seules les qualités de l’homme
S’y épuisent et s’y flétrissent ;
Au lourd portail l’Angoisse veille
Et le Désespoir aux supplices.
Parce qu’ils affament l’enfant
Effrayé, pleurant jour et nuit,
Flagellent le faible et l’idiot,
Raillent le vieux aux cheveux gris,
Certains deviennent fous ou pire
Et cela sans qu’un mot soit dit.
La cellule étroite où l’on vit
Est latrine obscure et souillée ;
Le souffle puant de la mort
Obstrue la lucarne grillée ;
Et tout est réduit en poussière
Dans la machine Humanité.
Ils nous donnent une eau saumâtre
Troublée de limon répugnant ;
Un pain dur, lourd de craie, de chaux,
Que l’on pèse soigneusement ;
Le Sommeil, hagard, ne dort pas,
Il marche en implorant le temps.
***
La faim maigre et la verte soif
Luttent tels vipère et aspic ;
Mais peu importe la pitance,
Ce qui nous glace et nous détruit,
C’est la pierre levée le jour
Qui devient notre cœur la nuit.
Minuit au cœur dans la cellule
Sombre, nous tournons le foret,
Nous rompons la corde en étoupe,
Chacun dans son Enfer privé,
Et le silence est plus affreux
Que la cloche d’airain sonnée.
Et jamais une voix humaine
Ne nous dit un mot d’amitié ;
Car l’œil derrière le judas
Reste sévère et sans pitié.
Là nous pourrissons dans l’oubli,
Le corps et l’âme saccagés.
Et ainsi, nous rouillons la chaîne
De la vie, seuls et dégradés.
Certains jurent et d’autres pleurent,
Lui ne s’est jamais lamenté.
Mais les lois de Dieu sont clémentes,
Un cœur de pierre y est brisé.
***
Dans la cellule ou dans la cour,
De chacun se brise le cœur,
Comme le vase qui donna
Son trésor à notre Seigneur,
Livrant dans l’antre du lépreux
Du nard les précieuses odeurs.
Ah ! Heureux l’homme au cœur brisé
Qui gagne du pardon la paix !
Comment sans réformer sa vie
Laver son âme du péché ?
Comment, sans un cœur qui se brise,
Le Seigneur pourrait-il entrer ?
***
L’homme à la gorge enflée et rouge,
L’homme aux yeux fixes et meurtris,
Attend la main sainte qui s’ouvre
Pour le larron en Paradis ;
Pour le cœur contrit et brisé,
Le Seigneur n’a aucun mépris.
L’homme en rouge qui lit la Loi
Laissa trois semaines de calme.
C’est un temps bien court pour soigner
Son âme en lutte avec son âme,
Et laver les gouttes de sang
Sur la main qui tenait la lame.
Et ses larmes de sang lavèrent
La lame et la main qui la tint ;
Seul le sang peut laver le sang,
Et les larmes donner les soins.
Le sceau du Christ blanc comme neige
Devint la marque de Caïn.
6
Dedans la geôle de Reading
Est une tombe d’infamie.
Dévoré par des dents de flamme,
C’est là qu’un misérable gît,
Il gît dans un linceul ardent
Aucun nom sur sa tombe écrit.
Laissons cet homme reposer.
Que le Christ appelle les morts !
Nul besoin de gâcher vos larmes
Ni d’exhaler de vains remords.
Il avait tué son amour
Aussi pour cela il est mort.
Pourtant chacun tue ce qu’il aime,
Salut à tout bon entendeur.
Certains le tuent d’un oeil amer,
Certains avec un mot flatteur,
Le lâche se sert d’un baiser,
Et d’une épée l’homme d’honneur.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Emile Nelligan : LES CORBEAUX
Emile Nelligan : LES CORBEAUX

Emile Nelligan (1879-1941)
LES CORBEAUX
J'ai cru voir sur mon coeur un essaim de corbeaux
En pleine lande intime avec des vols funèbres,
De grands corbeaux venus de montagnes célèbres
Et qui passaient au clair de lune et de flambeaux.
Lugubrement, comme en cercle sur des tombeaux
Et flairant un régal de carcasses de zèbres,
Ils planaient au frisson glacé de mes vertèbres.
Agitant à leurs becs une chair en lambeaux.
Or, cette proie échue à ces démons des nuits
N'était autre que ma Vie en loque, aux ennuis
Vastes qui vont tournant sur elle ainsi toujours,
Déchirant à larges coups de bec, sans quartier,
Mon âme, une charogne éparse au champs des jours,
Que ces vieux corbeaux dévoreront en entier.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Alfred de Musset
Alfred de Musset

LA VISION
- Ami, notre père est le tien.
Je ne suis ni l'ange gardien,
Ni le mauvais destin des hommes.
Ceux que j'aime, je ne sais pas
De quel côté s'en vont leurs pas
Sur ce peu de fange où nous sommes.
Je ne suis ni dieu ni démon,
Et tu m'as nommé par mon nom
Quand tu m'as appelé ton frère ;
Où tu vas, j'y serai toujours,
Jusqu au dernier de tes jours,
Où j'irai m'asseoir sur ta pierre.
Le ciel m'a confié ton cœur.
Quand tu seras dans la douleur,
Viens à moi sans inquiétude.
Je te suivrai sur le chemin ;
Mais je ne puis toucher ta main,
Ami, je suis la Solitude.

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 La nuit de décembre D’Alfred de Musset
La nuit de décembre D’Alfred de Musset
La nuit de décembre
D’Alfred de Musset (1810-1857)
LE POÈTE
Du temps que j'étais écolier,
Je restais un soir à veiller
Dans notre salle solitaire.
Devant ma table vint s'asseoir
Un pauvre enfant vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Son visage était triste et beau :
A la lueur de mon flambeau,
Dans mon livre ouvert il vint lire.
Il pencha son front sur sa main,
Et resta jusqu'au lendemain,
Pensif, avec un doux sourire.
Comme j'allais avoir quinze ans
Je marchais un jour, à pas lents,
Dans un bois, sur une bruyère.
Au pied d'un arbre vint s'asseoir
Un jeune homme vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Je lui demandai mon chemin ;
Il tenait un luth d'une main,
De l'autre un bouquet d'églantine.
Il me fit un salut d'ami,
Et, se détournant à demi,
Me montra du doigt la colline.
A l'âge où l'on croit à l'amour,
J'étais seul dans ma chambre un jour,
Pleurant ma première misère.
Au coin de mon feu vint s'asseoir
Un étranger vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Il était morne et soucieux ;
D'une main il montrait les cieux,
Et de l'autre il tenait un glaive.
De ma peine il semblait souffrir,
Mais il ne poussa qu'un soupir,
Et s'évanouit comme un rêve.
A l'âge où l'on est libertin,
Pour boire un toast en un festin,
Un jour je soulevais mon verre.
En face de moi vint s'asseoir
Un convive vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Il secouait sous son manteau
Un haillon de pourpre en lambeau,
Sur sa tête un myrte stérile.
Son bras maigre cherchait le mien,
Et mon verre, en touchant le sien,
Se brisa dans ma main débile.
Un an après, il était nuit ;
J'étais à genoux près du lit
Où venait de mourir mon père.
Au chevet du lit vint s'asseoir
Un orphelin vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Ses yeux étaient noyés de pleurs ;
Comme les anges de douleurs,
Il était couronné d'épine ;
Son luth à terre était gisant,
Sa pourpre de couleur de sang,
Et son glaive dans sa poitrine.
Je m'en suis si bien souvenu,
Que je l'ai toujours reconnu
A tous les instants de ma vie.
C'est une étrange vision,
Et cependant, ange ou démon,
J'ai vu partout cette ombre amie.
Lorsque plus tard, las de souffrir,
Pour renaître ou pour en finir,
J'ai voulu m'exiler de France ;
Lorsque impatient de marcher,
J'ai voulu partir, et chercher
Les vestiges d'une espérance ;
A Pise, au pied de l'Apennin ;
A Cologne, en face du Rhin ;
A Nice, au penchant des vallées ;
A Florence, au fond des palais ;
A Brigues, dans les vieux chalets ;
Au sein des Alpes désolées ;
A Gênes, sous les citronniers ;
A Vevey, sous les verts pommiers ;
Au Havre, devant l'Atlantique ;
A Venise, à l'affreux Lido,
Où vient sur l'herbe d'un tombeau
Mourir la pâle Adriatique ;
Partout où, sous ces vastes cieux,
J'ai lassé mon cœur et mes yeux,
Saignant d'une éternelle plaie ;
Partout où le boiteux Ennui,
Traînant ma fatigue après lui,
M'a promené sur une claie ;
Partout où, sans cesse altéré
De la soif d'un monde ignoré,
J'ai suivi l'ombre de mes songes ;
Partout où, sans avoir vécu,
J'ai revu ce que j'avais vu,
La face humaine et ses mensonges ;
Partout où, le long des chemins,
J'ai posé mon front dans mes mains,
Et sangloté comme une femme ;
Partout où j'ai, comme un mouton,
Qui laisse sa laine au buisson,
Senti se dénuder mon âme ;
Partout où j'ai voulu dormir,
Partout où j'ai voulu mourir,
Partout où j'ai touché la terre,
Sur ma route est venu s'asseoir
Un malheureux vêtu de noir,
Qui me ressemblait comme un frère.
Qui donc es-tu, toi que dans cette vie
Je vois toujours sur mon chemin ?
Je ne puis croire, à ta mélancolie,
Que tu sois mon mauvais Destin.
Ton doux sourire a trop de patience,
Tes larmes ont trop de pitié.
En te voyant, j'aime la Providence.
Ta douleur même est sœur de ma souffrance ;
Elle ressemble à l'Amitié.
Qui donc es-tu ? - Tu n'es pas mon bon ange,
Jamais tu ne viens m'avertir.
Tu vois mes maux (c'est une chose étrange !)
Et tu me regardes souffrir.
Depuis vingt ans tu marches dans ma voie,
Et je ne saurais t'appeler.
Qui donc es-tu, si c'est Dieu qui t'envoie ?
Tu me souris sans partager ma joie,
Tu me plains sans me consoler !
Ce soir encor je t'ai vu m'apparaître.
C'était par une triste nuit.
L'aile des vents battait à ma fenêtre ;
J'étais seul, courbé sur mon lit.
J'y regardais une place chérie,
Tiède encor d'un baiser brûlant ;
Et je songeais comme la femme oublie,
Et je sentais un lambeau de ma vie
Qui se déchirait lentement.
Je rassemblais des lettres de la veille,
Des cheveux, des débris d'amour.
Tout ce passé me criait à l'oreille
Ses éternels serments d'un jour.
Je contemplais ces reliques sacrées,
Qui me faisaient trembler la main :
Larmes du cœur par le cœur dévorées,
Et que les yeux qui les avaient pleurées
Ne reconnaîtront plus demain !
J'enveloppais dans un morceau de bure
Ces ruines des jours heureux.
Je me disais qu'ici-bas ce qui dure,
C'est une mèche de cheveux.
Comme un plongeur dans une mer profonde,
Je me perdais dans tant d'oubli.
De tous côtés j'y retournais la sonde,
Et je pleurais, seul, loin des yeux du monde,
Mon pauvre amour enseveli.
J'allais poser le sceau de cire noire
Sur ce fragile et cher trésor.
J'allais le rendre, et, n'y pouvant pas croire,
En pleurant j'en doutais encor.
Ah ! Faible femme, orgueilleuse insensée,
Malgré toi, tu t'en souviendras !
Pourquoi, grand Dieu ! Mentir à sa pensée ?
Pourquoi ces pleurs, cette gorge oppressée,
Ces sanglots, si tu n'aimais pas ?
Oui, tu languis, tu souffres, et tu pleures ;
Mais ta chimère est entre nous.
Eh bien ! Adieu ! Vous compterez les heures
Qui me sépareront de vous.
Partez, partez, et dans ce cœur de glace
Emportez l'orgueil satisfait.
Je sens encor le mien jeune et vivace,
Et bien des maux pourront y trouver place
Sur le mal que vous m'avez fait.
Partez, partez ! La Nature immortelle
N'a pas tout voulu vous donner.
Ah ! Pauvre enfant, qui voulez être belle,
Et ne savez pas pardonner !
Allez, allez, suivez la destinée ;
Qui vous perd n'a pas tout perdu.
Jetez au vent notre amour consumé ; -
Eternel Dieu ! Toi que j'ai tant aimée,
Si tu pars, pourquoi m'aimes-tu ?
Mais tout à coup j'ai vu dans la nuit sombre
Une forme glisser sans bruit.
Sur mon rideau j'ai vu passer une ombre ;
Elle vient s'asseoir sur mon lit.
Qui donc es-tu, morne et pâle visage,
Sombre portrait vêtu de noir ?
Que me veux-tu, triste oiseau de passage ?
Est-ce un vain rêve ? Est-ce ma propre image
Que j'aperçois dans ce miroir ?
Qui donc es-tu, spectre de ma jeunesse,
Pèlerin que rien n'a lassé ?
Dis-moi pourquoi je te trouve sans cesse
Assis dans l'ombre où j'ai passé.
Qui donc es-tu, visiteur solitaire,
Hôte assidu de mes douleurs ?
Qu'as-tu donc fait pour me suivre sur terre ?
Qui donc es-tu, qui donc es-tu, mon frère,
Qui n'apparais qu'au jour des pleurs ?

davidof- Nombre de messages : 2697
loisirs : pêche, voyage, music...
Date d'inscription : 21/05/2008
 Le sommeil-D’Augustine Malvina Blanchecotte
Le sommeil-D’Augustine Malvina Blanchecotte
Le Sommeil
(1830-1895)
Les perdus, les absents, les morts que fait la vie,
Ces fantômes d'un jour si longuement pleurés,
Reparaissent en rêve avec leur voix amie,
Le piège étincelant des regards adorés.
Les amours prisonniers prennent tous leur volée,
La nuit tient la revanche éclatante du jour.
L'aveu brûle la lèvre un moment descellée.
Après le dur réel, l'idéal a son tour !
Ô vie en plein azur que le sommeil ramène,
Paradis où le cœur donne ses rendez-vous,
N'es-tu pas à ton heure une autre vie humaine,
Aussi vraie, aussi sûre, aussi palpable en nous,
Une vie invisible aussi pleine et vibrante
Que la visible vie où s'étouffent nos jours,
Cette vie incomplète, inassouvie, errante,
S'ouvrant sur l'infini, nous décevant toujours ?
(1830-1895)
Les perdus, les absents, les morts que fait la vie,
Ces fantômes d'un jour si longuement pleurés,
Reparaissent en rêve avec leur voix amie,
Le piège étincelant des regards adorés.
Les amours prisonniers prennent tous leur volée,
La nuit tient la revanche éclatante du jour.
L'aveu brûle la lèvre un moment descellée.
Après le dur réel, l'idéal a son tour !
Ô vie en plein azur que le sommeil ramène,
Paradis où le cœur donne ses rendez-vous,
N'es-tu pas à ton heure une autre vie humaine,
Aussi vraie, aussi sûre, aussi palpable en nous,
Une vie invisible aussi pleine et vibrante
Que la visible vie où s'étouffent nos jours,
Cette vie incomplète, inassouvie, errante,
S'ouvrant sur l'infini, nous décevant toujours ?

roby- Nombre de messages : 1357
Date d'inscription : 28/10/2008
 D’Alphonse Beauregard : le damné
D’Alphonse Beauregard : le damné
LE DAMNE
(1881-1924)
Je voudrais que la nuit fût opaque et figée,
Définitive et sourde, une nuit d'hypogée ;
J'oserais approcher, soudainement hardi,
De la femme pour qui je suis un grain de sable,
Et d'un mot lui crier mon rêve inguérissable.
Elle ne rirait pas, devinant un maudit.
Pour m'imposer à sa pitié de curieuse,
Je ferais de mon corps une chose hideuse
Et m'en irais pourrir sur un lit d'hôpital.
Mais de plaisir son coeur est seulement avide,
Pour son linge elle craint une senteur d'acide.
Elle ne viendrait pas diviniser mon mal.
Ayant dit mon amour et ma désespérance,
Je me tuerais avec bonheur, en sa présence,
Pour la voir essayant d'un geste à m'arrêter.
Elle ne s'émeuvrait que la balle partie,
Et, contente d'avoir un drame dans sa vie,
Raconterait ma mort d'un faux air attristé.
Depuis longtemps le feu des damnés me possède,
L'enfer m'attend. Que nul ne prie ou n'intercède.
Qu'elle puisse me voir un instant, de son ciel,
Debout, grave et hautain, sur les rocs de porphyre,
Illuminé comme sa chair que je désire,
Je ne me plaindrai pas du supplice éternel.
(1881-1924)
Je voudrais que la nuit fût opaque et figée,
Définitive et sourde, une nuit d'hypogée ;
J'oserais approcher, soudainement hardi,
De la femme pour qui je suis un grain de sable,
Et d'un mot lui crier mon rêve inguérissable.
Elle ne rirait pas, devinant un maudit.
Pour m'imposer à sa pitié de curieuse,
Je ferais de mon corps une chose hideuse
Et m'en irais pourrir sur un lit d'hôpital.
Mais de plaisir son coeur est seulement avide,
Pour son linge elle craint une senteur d'acide.
Elle ne viendrait pas diviniser mon mal.
Ayant dit mon amour et ma désespérance,
Je me tuerais avec bonheur, en sa présence,
Pour la voir essayant d'un geste à m'arrêter.
Elle ne s'émeuvrait que la balle partie,
Et, contente d'avoir un drame dans sa vie,
Raconterait ma mort d'un faux air attristé.
Depuis longtemps le feu des damnés me possède,
L'enfer m'attend. Que nul ne prie ou n'intercède.
Qu'elle puisse me voir un instant, de son ciel,
Debout, grave et hautain, sur les rocs de porphyre,
Illuminé comme sa chair que je désire,
Je ne me plaindrai pas du supplice éternel.

roby- Nombre de messages : 1357
Date d'inscription : 28/10/2008
Page 5 sur 8 •  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Page 5 sur 8
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|

 Portail
Portail Dernières images
Dernières images S'enregistrer
S'enregistrer Connexion
Connexion